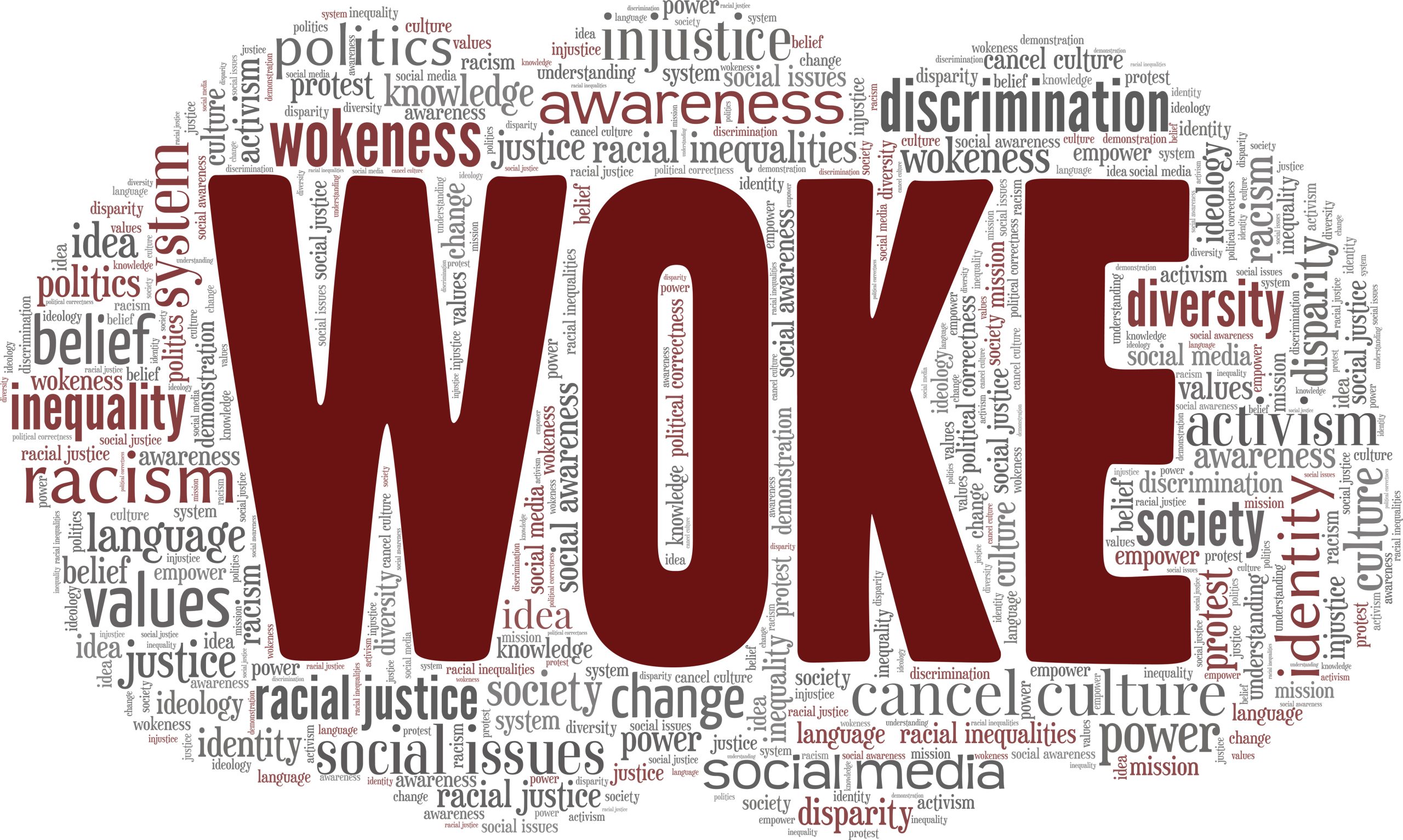Compte rendu - Fabien Jobard, commentée par Leslie Touré Kapo
À la suite de la mort de Zyed Benna (17 ans) et Bouna Traoré (15 ans) en 2005 à Clichy-sous-Bois, puis de Nahel Marzouk (17 ans) en 2023 à Nanterre, la France a connu d’importantes vagues de révoltes urbaines. Ces événements tragiques, impliquant des jeunes des banlieues lors de confrontations avec la police, ont déclenché des soulèvements massifs, qui se sont étendus à l’échelle nationale. Que peut nous apprendre l’histoire sur l’origine de ces soulèvements? Quelles similitudes et différences y a-t-il entre ceux de 2005 et 2023? Comment comprendre leur dimension politique et symbolique? Chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Fabien Jobard analyse ces révoltes à travers des données statistiques, des entretiens et des observations participantes, offrant une perspective historique et comparative des révoltes et des réponses répressives de l’État de 2005 et 2023. Ces recherches s’inscrivent dans une demande faite par les ministres français de l’Intérieur et de la Défense.
Compte rendu - Conférence de Thierry Ramadier
La cartographie cognitive est à la fois un outil créé pour comprendre la façon dont les individus se représentent l’espace et un processus cognitif par lequel les individus passent pour se représenter l’espace. La psychologie et en particulier la psychologie sociale et environnementale se sont très tôt intéressées aux rôles joués par les représentations pour comprendre les comportements des individus à travers l’espace et leurs usages de l’espace. Ces courants étudient les façons de représenter l’espace en fonction des occupations, activités, usages et aménagements qui donnent sens à l’espace et ses différentes formes.
Compte rendu – Conférence de Denise Helly, commentée par Raphaël Canet et Léo Palardy
Helly se penche sur la construction discursive du wokisme : comment ce discours est-il construit, articulé? Qui le crée, qui le prononce? Puisque l’ascension anti-woke est polymorphe, la chercheuse juge d’abord nécessaire de distinguer son élaboration dans de multiples régions et contextes. En France, la réaction anti-woke s’établit dans les rangs de l’élite intellectuelle et universitaire, entre philosophes possédant une grande légitimité discursive. L’opinion publique française n’est pas encore largement atteinte pour l’instant, selon Helly. Aux États-Unis, l’anti-wokisme se situe dans une autre arène : il s’agit plutôt d’un mouvement social populiste. Finalement, au Québec, le phénomène anti-woke s’alimente plutôt dans la sphère médiatique. Une poignée de chroniqueur·euse·s tels que Martineau, Durocher, Bock-Côté, Bombardier et Facal nourrissent la controverse. Il fut question plus spécifiquement de ce phénomène dans la présentation de Canet et Palardy.
Compte rendu - Conférence d'Isabelle Baraud-Serfaty
Le trottoir marque notre imaginaire par les multiples représentations qu’on lui accorde, par exemple dans la littérature ou encore dans la conception qu’a l’enfant de son espace. D’un point de vue historique, les trottoirs les plus anciens ont été découverts à Pompéi. Par la suite, ils ont cessé d’être construits en Europe jusqu’à la suite de l’incendie de Londres en 1666, où l’aménagement de la nouvelle trame viaire prévoit alors des trottoirs. En France, la loi sur le financement des trottoirs de 1845 en a fait leur généralisation à travers les différentes régions urbaines du pays. Cependant, la seconde moitié du 20e siècle a été marquée par la disparition des trottoirs en raison de la priorité accordée à la voiture dans la conception de nos villes. Depuis, plusieurs courants en urbanisme visent à redonner la place aux espaces piétonniers, notamment en considérant la marchabilité (l’accessibilité piétonne) comme indicateur de qualité de vie en milieu urbain.
La présentation d’Isabelle Baraud-Serfaty a permis de mettre en lumière deux enjeux contemporains sur la place des trottoirs dans nos villes, soit la valeur du trottoir ainsi que la distinction entre le domaine public et le domaine privé dans sa gouvernance.
Compte rendu - Conférence de Laurent Devisme, commentée par Meg Holden
Que signifie « écologiser » les études urbaines? C’est la question soulevée lors d’une rencontre unique entre deux langues et deux continents. Laurent Devisme, professeur d’études urbaines à l’ENSA Nantes et chercheur à l’UMR Ambiances, architectures, urbanités (CRENAU), a entamé la discussion en abordant les transitions socioécologiques et leurs implications pour les méthodologies et les connaissances, ainsi que les pratiques et les formations des chercheurs et des chercheuses. Son intervention a été suivie par un commentaire de Meg Holden, professeure-chercheuse en études urbaines et en gestion des ressources et de l’environnement à l’Université Simon Fraser, qui a présenté ces enjeux critiques dans un contexte canadien.
Compte rendu - Conférence de Bruce Appleyard
Livable Streets 2.0 (2020) de Bruce Appleyard est la suite du livre original Livable Streets publié en 1981 par Donald Appleyard, père du professeur Appleyard. Lors de la présentation du 20 juillet 2023, l’auteur a pu exposer les meilleures pratiques et des données probantes afin de réduire la place de l’automobile au profit de rues plus vivantes et animées. Cette réappropriation de la rue au détriment de l’automobile est sous-jacente à trois thèmes centraux présentés lors de la conférence : le conflit, le pouvoir et la promesse.
Charger davantage de contenu