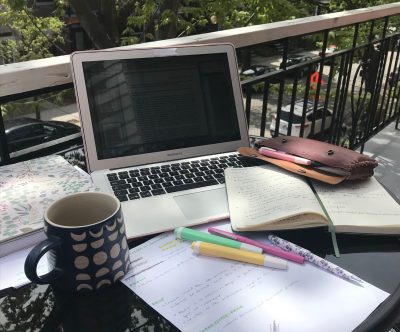Entrevue et édition : Valérie Vincent (Juillet 2020)
Stéphane Guimont Marceau est professeure en études urbaines à l’INRS; Magalie Quintal Marineau est professeure en étude des populations à l’INRS; Laurent Vernet est chargé de cours en études urbaines à l’UQAM et chercheur invité en histoire de l’art à l’Université de Montréal
Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet « Recherche et pandémie » piloté par le réseau Villes Régions Monde. Elle porte toutefois sur les répercussions de la crise de la COVID-19 sur l’enseignement.
Est-ce que vous pouvez me dire sur quoi portait le cours que vous avez enseigné à la session d’été 2020 à l’INRS ?
SGM : il s’agissait en fait de deux cours qui devaient se donner à la session d’été en études urbaines à l’INRS – Urbanisation Culture Société. Le premier, c’est le cours Montréal, ruptures et continuités qui est un séminaire qui existe depuis très longtemps (offert conjointement avec l’UQAM) et qui est ce qu’on appelle « un cours de terrain », donc basé sur plusieurs visites en présentiel dans la ville. L’autre, c’est un cours qui devait se donner pour la première fois cette année et que Magalie et moi-même avions réfléchi depuis plusieurs mois. Il s’intitulait Espaces de marginalisation et de résistance et devait se donner sur 5 jours intensifs en mai 2020. En raison de la crise actuelle, nous avons bien sûr été obligées de revoir entièrement l’enseignement. Il était par exemple impensable pour nous de donner cinq journées de cours consécutives en ligne. On a donc pensé à une formule hybride, d’une part entre les deux cours pour permettre aux étudiant.es d’accéder à plus de contenu et, d’autre part, en alternant entre la présence en ligne en synchrone et un forum virtuel accessible 24h/24 dans lequel on retrouvait du contenu déposé à la fois par les enseignant.es et par les étudiant.es.
MQM : si je peux ajouter, l’idée de fusionner les deux séminaires de maîtrise, c’était aussi de réfléchir à une thématique commune – la crise actuelle – vécue et analysée à partir de deux perspectives différentes : la perspective de Montréal (pour les étudiant.es du cours Montréal, rupture et continuité) et la perspective des espaces socio spatiaux (pour les étudiant.es du cours Espaces de marginalisation et de résistance). Le point d’ancrage, c’était donc la crise actuelle afin d’amener les étudiant.es à réfléchir à partir de différentes perspectives.
SGM : la crise a, bien entendu, été une opportunité pour faire ressortir les inégalités et les espaces de marginalisation principalement à Montréal.
Comme ce sont des cours qui, en temps normal, nécessitent plusieurs visites sur le terrain, comment avez-vous réussi à adapter le contenu ?
LV: plutôt que d’aller sur le terrain, on a choisi d’inviter des experts à présenter des conférences virtuelles. Deux invité.es par séance thématique sont venu.es nous parler de leurs réalités et cela a été très apprécié des étudiant.es parce que c’était un moyen pour eux de prendre contact avec les réalités du terrain et de mieux comprendre comment elles sont vécues. Dans bien des cas, ces invité.es avaient également une posture de chercheur.e et ils étaient en mesure de faire le lien avec des données. On a aussi reçu des professeur.es comme Maude Pugliese de l’INRS qui a fait le lien entre la crise actuelle et les enjeux économiques, notamment le surendettement des ménages. L’idée c’était de réfléchir à ce type de question « à chaud » par rapport à la crise actuelle, mais lorsqu’on parle par exemple d’inégalités, il faut savoir que ce sont quand même des dynamiques qui existent depuis toujours.
SGM : oui, c’est vrai! On a présenté des contenus beaucoup plus théoriques. Il fallait que les étudiant.es puissent réfléchir à la crise actuelle, mais en se basant sur des approches théoriques plus larges qui existent depuis très longtemps. C’est ce qu’on a tenté de transmettre aux étudiant.es lors de chaque séance virtuelle.
MQM : on peut dire que la pandémie ne s’est pas juste invitée dans le cours. En tant qu’enseignant.es, on a en quelque sorte choisi de prendre la pandémie comme point d’ancrage pour explorer des dynamiques telles que les enjeux raciaux, économiques ou sociaux.
LV : on a aussi demandé aux étudiant.es d’être assez pragmatiques dans la réalisation de leurs travaux de fin de session et de réaliser une capsule thématique qui s’inscrit dans une démarche de transfert et mobilisation des connaissances. À titre d’exemple, une étudiante s’est penchée sur la question des ruelles vertes en temps de pandémie et sur le rôle que celles-ci jouent alors que les gens avaient difficilement accès à des espaces verts. On leur a aussi demandé de réfléchir aux conditions d’apprentissage en contexte de pandémie : qu’est-ce que j’ai appris sur Montréal alors que j’étais confiné.e chez moi ?
SGM : le fait d’axer l’évaluation principale du cours sur un travail de mobilisation des connaissances (la création de la capsule thématique) a sorti les étudiants.es d’une zone à laquelle ils sont habitués. Pour moi, c’est un plus qui a été encouragé par le format virtuel.
LV : durant la pandémie, on a beaucoup vu les chercheurs produire ce type de contenu plus vulgarisé et destiné à un plus large public. Les chercheurs ont senti le besoin de se prononcer sur la situation actuelle et on a amené les étudiant.es à faire ce même exercice.
SGM : un des mécanismes d’évaluation que nous avons utilisé, c’est l’évaluation par les pairs. En petits groupes, on leur a demandé de lire les capsules de leurs collègues afin de leurs fournir des commentaires constructifs. Ça a permis aux étudiant.es de bonifier leur travail de session.
Qu’est-ce que vous pensez de l’enseignement à distance ? Est-ce que ça été une expérience positive pour vous et pour les étudiant.es ?
LV : ce qui est ressorti, de la part des étudiant.es, c’est le manque de sociabilité… ces conversations de corridors qui permettent de réfléchir, de faire des liens et qui peuvent même changer le cours d’un travail de session. Toutes ces interactions n’ont pas pu se produire et c’est dommage! Nous-même, en tant qu’enseignant, on ne s’est jamais rencontrés en personne pendant toute cette période. Magalie et Stéphane se connaissent déjà puisqu’elles travaillent toutes les deux à l’INRS, mais moi, je ne les ai jamais rencontrées autrement que sur Zoom. On a eu beaucoup de rencontres virtuelles en préparation du cours, alors je pense qu’on a quand même réussi à créer un climat de socialisation.
MQM : en virtuel, le cours se termine et l’ordinateur s’éteint! Les étudiant.es ont noté qu’il manquait cet espace de transition entre le moment où le cours se termine et le moment où ils et elles se retrouvent chez eux. C’est comme s’il n’y avait plus de frontière entre l’espace d’apprentissage et le chez-soi. C’est revenu souvent dans leurs commentaires.
SGM : mon enseignement est largement basé sur la relation que je créée avec les étudiant.es et cette fois-ci, elle était moins facile à construire. Je crois que c’est sans doute le plus grand handicap de ce type d’enseignement. Par contre, à ma grande surprise, on a réussi à créer un certain esprit de groupe, en tout cas, pour certains étudiant.es. On a quand même eu de bons échanges.
Je dirais aussi qu’en virtuel, le risque « d’échapper » des étudiant.es est très présent. C’est vrai aussi en présentiel, mais le virtuel fait en sorte qu’il est facile pour certains étudiant.es de rester en marge du cours, de ne pas participer. On ne sait pas s’ils font les lectures obligatoires, ils peuvent éteindre leur caméra, disparaître un certain temps. Je pense que cet aspect est exacerbé en virtuel. C’est plus difficile pour nous, les enseignant.es, de garder tout le monde présent.
LV : j’ajouterais que le fait de créer le climat propice à l’apprentissage, ça revient aussi un peu à l’étudiant.e. Nous, on a mis en place un code vie dès le départ : se présenter à l’heure le matin, lever la main pour prendre la parole pendant le cours, mais il y a une partie de ça qui est de la responsabilité des étudiant.es aussi. J’ai moi-même suivi ce cours il y a une dizaine d’années et je me rappelle que certaines visites sur le terrain avaient vraiment changé ma manière d’appréhender la ville. Je ne sais pas si on a réussi à susciter ça cette fois-ci, peut-être en partie chez certains étudiant.es.
SGM : on a été créatifs, mais la visite de terrain ne se remplace pas tellement. Visiter un terrain, c’est aussi faire une heure et demie d’autobus pour se rendre dans un quartier, parler aux gens, prendre connaissance du cadre bâti, de l’ambiance, du climat. Tout ça fait partie du cours en temps normal.
MQM : par rapport à l’enseignement virtuel, quand on a commencé à préparer le cours à la fin mars, il y avait tellement d’incertitude. On a commencé le cours et les étudiant.es pouvaient à peine sortir de chez eux. Progressivement, les règles se sont assouplies. On a traversé tous ces événements avec les étudiant.es et le cours a évolué en même temps. Dans notre cas, notre préoccupation n’a pas juste été d’enseigner le cours en ligne, ça aussi été d’évoluer avec l’état de la situation.
MQM : je pense qu’on a réussi à concevoir une formule qui nous a permis de présenter les mêmes contenus qu’en présentiel, mais je ne pense pas que pour les étudiant.es l’expérience générale du cours est la même en virtuel. Nous avons forcément dû nous adapter et les étudiant.es aussi. Je pense qu’on a réussi sur certains points.
LV : il n’y a pas d’expérience d’enseignement parfaite de toute façon. Il y a toujours des choses à améliorer et ça reste un espace de co-construction. On a amené des possibles. Je pense qu’on était plutôt en mode exploratoire et que les étudiant.es ont pris la balle au bond. Ils ont réagi du mieux qu’ils pouvaient.
MQM : à la lumière de certains commentaires que j’ai lu des étudiant.es, il y avait beaucoup d’angoisse associé à la situation. Si, pour certains, le cours leur permettait d’avoir une certaine emprise sur la crise, ça n’a pas été le cas pour tous. C’est quelque chose que j’ai réalisé après coup. Des sondages avaient été réalisés auprès des étudiant.es de l’INRS et je savais que la situation était anxiogène pour eux, mais c’est devenu plus concret avec le cours. C’est vraiment à la fin du cours que j’ai pu constater les difficultés individuelles vécues par les étudiant.es.
SGM : dès le départ, on construisait le cours dans un contexte où tout était incertain. On ne savait pas si nous-mêmes on allait attraper le virus, si des étudiant.es allaient devoir s’absenter. On savait par contre que c’était anxiogène, on savait que certains étudiant.es n’avaient pas accès à la technologie, il a fallu construire le cours avec toutes ces données-là. Ça été une expérience d’enseignement dans un contexte extrêmement incertain.
Justement, qu’en est-il de l’aspect technologique ?
On s’est bien approprié les outils virtuels, mais on a bien sûr eu quelques pépins techniques. On a dû mobiliser des employés de l’INRS en urgence. On a mis beaucoup d’heures à essayer de démystifier certains autres outils technologiques, par exemple le forum virtuel. On s’est rendu compte après coup que la plateforme sur laquelle on l’avait hébergé n’était pas idéale.
MQM : je pense que l’enjeu de la fracture numérique était réel. Quelques étudiant.es nous ont signifié au début du cours qu’ils n’avaient pas de caméra, on ne les a donc jamais vus! On les a entendus et lus, mais jamais vus. C’est quand même particulier pour des enseignants de ne pas voir les étudiant.es. Somme toute, on n’a pas rencontré d’obstacle plus important. Je pense, par contre, que ça pourrait devenir un enjeu pour les sessions régulières de l’automne et de l’hiver, ça pourrait représenter un frein pour certains étudiant.es.